C'est pas demain la veille
Comme toutes les deux semaines, l’Institut des Transitions de l’Université de Rouen Normandie (T.URN) vous propose une veille sur les sujets relatifs à la transition socio-écologique. Bonne lecture !
L’AMOC, vous connaissez ? Cet acronyme signifie « Atlantic Meridional Overturning Circulation » qui en bon français désigne la circulation méridienne de retournement Atlantique. Parler de l’AMOC, c’est se confronter à un sujet complexe. Pour simplifier, on dira qu’il s’agit de courants marins qui participent à la circulation des masses d’eaux chaudes de l’équateur vers le nord de l’océan Atlantique (comme un « tapis roulant » et parmi les plus connus, on peut mentionner le « Gulf Stream« ). Ces courants marins sont essentiels pour le climat continental européen par exemple : ils remontent la chaleur du sud (Golfe du Mexique) vers le nord (mer de Norvège) et embarquent avec eux nutriments, carbone et oxygène, assurant à l’Europe occidentale des hivers « plus doux » que dans d’autres régions du monde pourtant sur les mêmes latitudes (le nord des États-Unis ou le Canada).
Mais alors, que se passe t-il avec l’AMOC ?
Restons dans l’eau. Comment les fronts océaniques jouent-ils un rôle crucial pour la vie marine ? C’est l’objet d’un dossier du CNRS dernièrement. Voilà quelques éléments que nous pouvons en retenir :
Une révolution. C’est en ces termes qu’est souvent présentée la grande innovation nommée « Intelligence Artificielle » ou « IA » mais qui, dans le langage courant, désigne surtout les solutions d’intelligence artificielle générative. Dans un article paru il y a peu sur le site bonpote, Lou Welgryn et Théo Alves Da Costa (de DataforGood) ont livré leur analyse du véritable coût environnemental de l’IA. Un article à lire, surtout si vous souhaitez en savoir plus sur la longue histoire de ce qu’on appelle l’IA. Voilà une courte synthèse de l’article (que nous vous recommandons de lire en intégralité) :
Comment faciliter la transition des compétences et des emplois vers des secteurs plus vertueux pour l’environnement ? Plusieurs dispositifs existent à ce sujet, dont le « fonds de transition juste ». Issu d’une directive européenne, il fait partie des éléments amenés par le Pacte vert européen et propose différents aménagements concourant à la décarbonation de l’économie. Voici comment :
Comment repenser les espaces et mieux appréhender les « solutions naturelles » en cas d’aléas climatiques ? C’est en partant de cette interrogation que l’IGN (l’institut national de l’information géographique et forestière) a fini par déboucher sur la réalisation d’une cartographie du risque « inondations » pour la France. Voici ce qu’il faut en retenir, en quelques points :
Habiter le monde fluctuant : robustesse ou performance ?
Le mardi 14 octobre 2025, l’Université et la CCI de Rouen vous proposent une soirée spéciale dédiée à différents concepts : « robustesse », « fluctuation », « contraintes ». Comment anticiper l’instabilité généralisée dans un monde qui s’est progressivement habitué à la stabilité (qui a modelé nos infrastructures modernes) ?
Voilà le genre de grandes questions qui seront à l’ordre du jour à l’occasion du cycle de conférences animé par le chercheur Olivier Hamant (chercheur biologiste à l’INRAE) et deux représentants de la méthode TELED (pour tâches énergivores lorsque l’énergie est disponible) que sont Arnaud Crétot (NéoLoco) et Loic Perochon (La Belle Tech).
Si vous souhaitez être présent, cet évènement se tiendra sur le campus Pasteur de l’Université de 18h à 20h30. Inscription ici
De la fin du mois d’août jusqu’au début du mois d’octobre, le dispositif « Bienvenue à l’Université » permet aux nouveaux étudiants (et pas que) de découvrir le fonctionnement de l’Université : ses campus, les associations que l’on peut y trouver, ses services…
Et justement. Du 22 au 30 septembre, l’Institut T.URN animera avec les autres services de l’établissement la « caravane des services ». Le concept : visiter tous les campus de l’Université de Rouen (un différent chaque jour de la semaine), tenir un stand en proposant des activités ludiques présentant les missions de l’Institut TURN et donner l’envie aux étudiants de s’engager dans la transition socio-écologique au quotidien.
Voici notre programme :
Dans le Greenletter Club, la parole est donnée à des personnalités et experts pour décortiquer les grands sujets écologiques. Des capitaines d’industrie aux patrons d’ONG, en passant par les spécialistes du pétrole, pendant une heure environ, un voyage au cœur des sujets complexes est proposé aux auditeurs. Le but : décrypter les enjeux de notre siècle, les opportunités comme les menaces.
Encore un podcast que nous vous recommandons ! Bonne écoute !
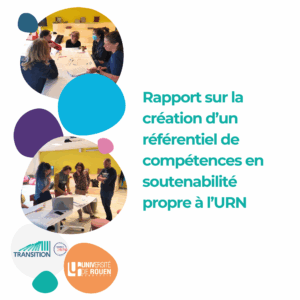
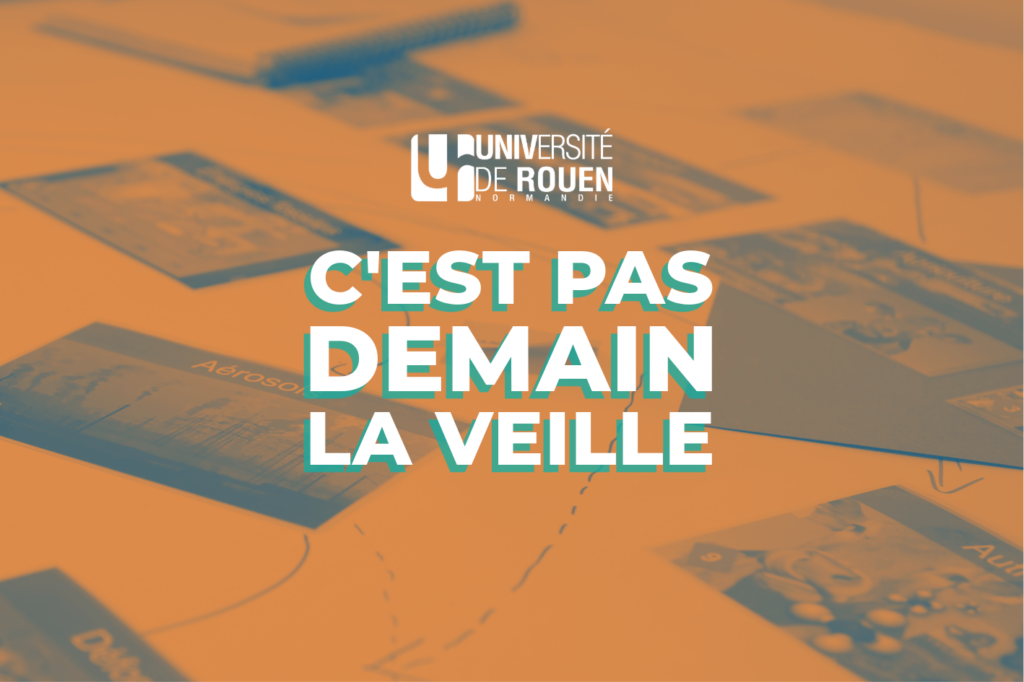
L’équipe de l’Institut T.URN est à votre disposition si vous souhaitez des précisions sur certaines ressources, actualités, ou fiches d’annuaire.
Et si vous voulez que votre structure intègre l’annuaire, ou porter à notre connaissance un évènement ayant le lieu sur le territoire, remplissez le formulaire de contact.